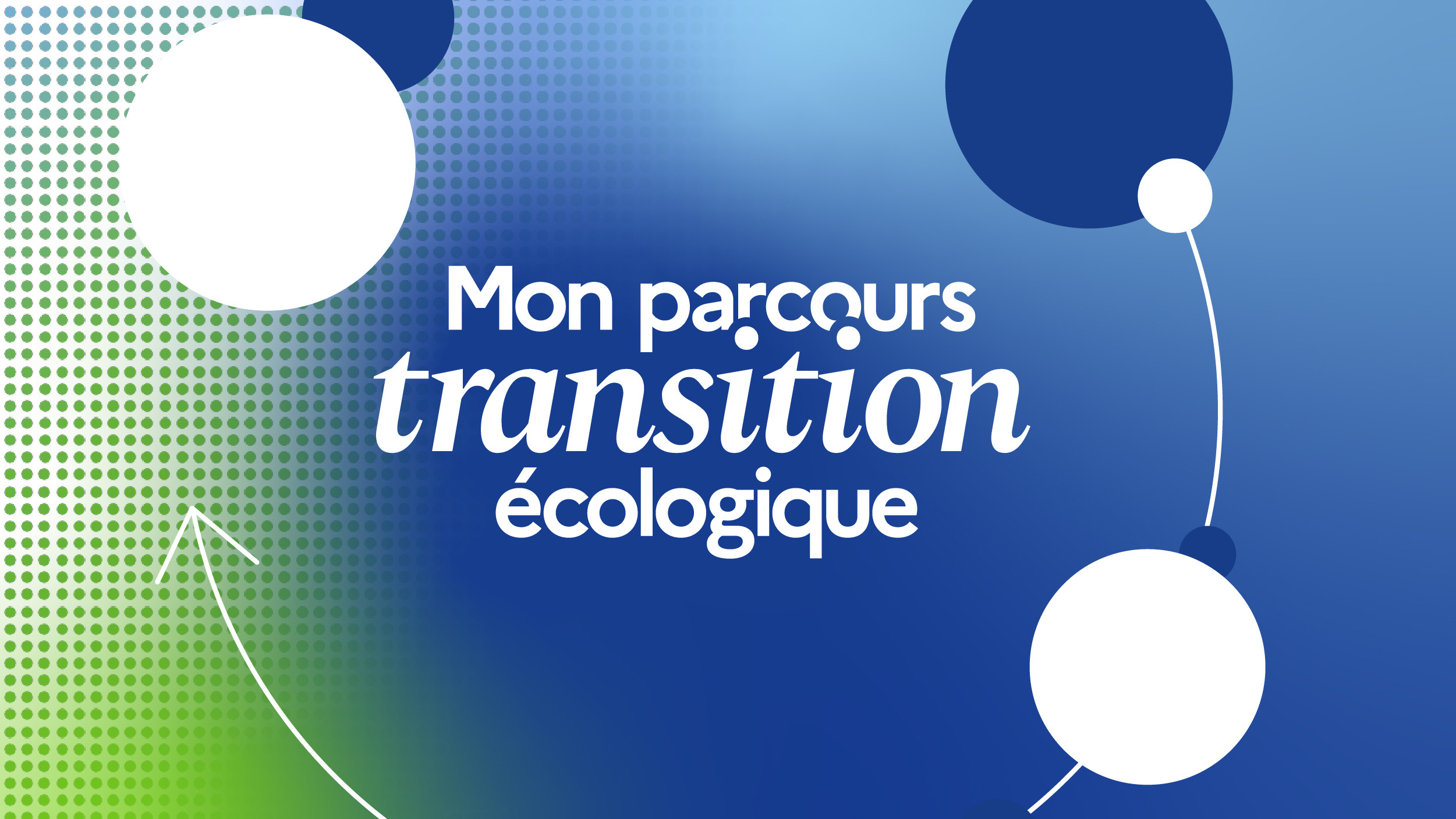
Conférences-débats Climat, Biodiversité, Ressources - La Réunion
au mardi 31 décembre 2024, 18:00
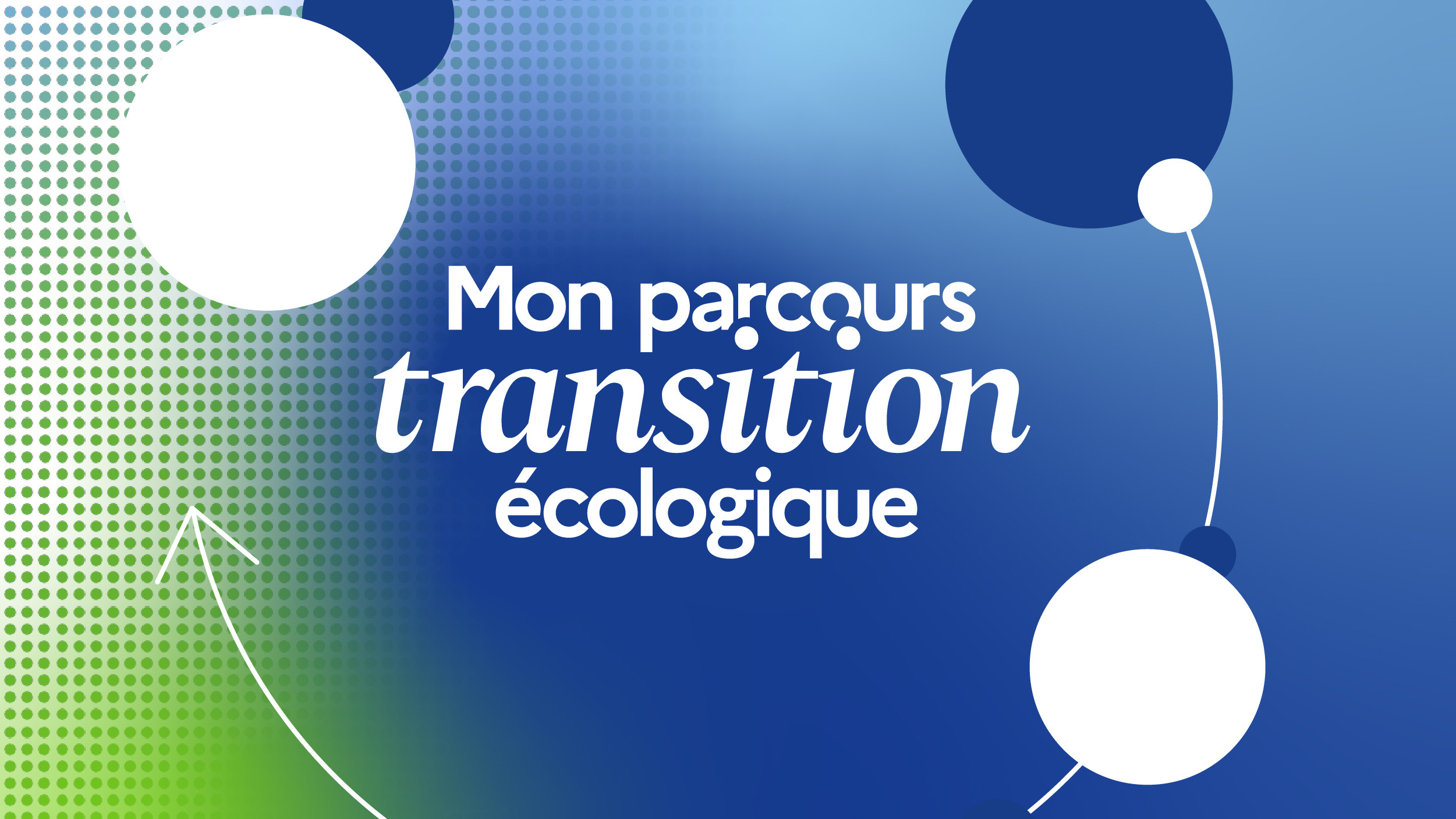
Conférences-débats Climat, Biodiversité, Ressources - La Réunion
au mardi 31 décembre 2024, 18:00
Ingénieur diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure de l'Energie, l'Eau et l'Environnement (ENSE3) de Grenoble INP, j'ai débuté en 2022 une thèse de doctorat en Physique Énergétique appliquée aux espaces bâtis au laboratoire PIMENT (Physique et Ingénierie Mathématiques pour l'Energie, l'Environnement et le Bâtiment) de l'Université de la Réunion. Mes recherches portent sur l'analyse du climat urbain, le confort thermique, ainsi que les stratégies de réduction des îlots de chaleur urbains comme solutions d'adaptation au réchauffement climatique, avec un focus particulier sur les environnements tropicaux.
Directrice de Recherche à l'IRD, UMR LOCEAN-IPSL (Sorbonne Univ-IRD-CNRS-MNHN, Paris), affectée depuis 2022 à la Réunion. Ecologue récifale travaillant depuis près de 25 ans à l'échelle de l'Indo-Pacifique sur les effets de perturbations anthropiques locales et le changement climatique sur le fonctionnement et la résilience des récifs coralliens, écosystèmes majeurs en milieu marin puisqu'ils abritent 25% de la biodiversité marine, protègent les côtes et îles d l'assaut des vahues/tempêtes/cyclones/tsunami, fournissent d'innombrables services écosystémiques estimés à plusieurs centaines de milliards de $US (alimentation, tourisme, pêche...). La plupart des récifs se trouve dans la zone intertropicale où de très nombreux pays en voie de développement se trouvent. Ils dépendant entière pour leur survie des services écosystémiques rendus par les récifs.
Chef de projet en hydrogéologie et en risques naturels, rattaché depuis 2007 au BRGM de La Réunion, suite à son doctorat sur la modélisation des aquifères côtiers du Roussillon. Sur le territoire de La Réunion, il intervient (i) sur les expertises d’urgence suite aux événements extrêmes affectant La Réunion, (ii) dans le cadre de projets opérationnels d’appui aux politiques publiques et sur une dimension élargie de projets de recherche appliquée. En hydrogéologie, ses activités visent à aborder les questions quantitatives et qualitatives de la ressource en eau souterraine (intrusion saline, pollutions diffuses, évaluation des volumes prélevables…) en utilisant des approches interdisciplinaires croisant la modélisation multi-échelle, les outils hydrochimiques et de l’acquisition de données géophysiques.
En tant qu'Enseignant-Chercheur au laboratoire PIMENT de l'Université de La Réunion, je me spécialise dans l'étude performantielle du bâti tropical. Mon travail se concentre sur les enveloppes novatrices, privilégiant l'utilisation de matériaux biosourcés, géosourcés et recyclés. J'analyse également la qualité de l'ambiance intérieure en vue d'une gestion énergétique optimale, et j'explore les modes de conception idéaux pour les architectures bioclimatiques/vernaculaires. En qualité de responsable du centre d'essai LABiMAC, je développe et caractérise de nouveaux matériaux adaptés aux bâtiments tropicaux, en parallèle de mon rôle de porteur du projet MATARUN, qui explore les possibilités de la terre dans le secteur de la construction réunionnais. Guidé par un fort engagement envers la durabilité environnementale, je dirige le Programme de Transition Écologique et Environnementale de mon université (PROTECTEUR), démontrant ainsi ma passion pour l'innovation durable et ma volonté de relever les défis actuels et futurs dans notre contexte tropical et insulaire.
Ingénieure agronome en amélioration des plantes et maître de conférences en génomique des populations à l'Université de la Réunion depuis 2020, elle s'intéresse à biologie des plantes et à aux biostatistiques, mais aussi à la génétique et en particulier sur les technologies de séquençage à haut débit de l'ADN. Elle effectue ses activités de recherche à l'UMR PVBMT (Peuplements Végétaux et Bioagresseurs en Milieu Insulaire) où elle réalise des études de génétique chez les populations de plantes, quelles soient sauvages (endémiques, indigènes) ou cultivées. Elle s'implique dans des programmes de recherche qui visent à étudier la diversité génétique et les processus d'adaptation locale chez les espèces endémiques des Mascareignes en vue de leur conservation et/ou de leur valorisation. Chez les plantes cultivées, elle est associée à des travaux de recherche de facteurs de résistance génétique (QTL) au flétrissement bactérien chez l'aubergine, dans un objectif d’amélioration des variétés cultivées localement.
Professeure des universités en Aménagement du territoire et Urbanisme, je manage l’unique formation en Urbanisme de l’Université de La Réunion : le master Ville et Environnements Urbains. Mes travaux portent sur la dynamique de développement des territoires isolés dans un contexte de transition énergétique. Avec en perspective la vulnérabilité des espaces et des communautés, mes travaux évaluent la performances des initiatives gouvernementales et les capacités territoriales à assurer la transition énergétique et les enjeux de décarbonation qui y sont associés dans différents secteurs : transport, déchets, bâtiment, etc.
Chercheure Météo-France, elle est directrice adjointe du Laboratoire de l'Atmosphère et des Cyclones (LACy) pour la tutelle Météo-France et responsable de l’équipe Cyclones et Météorologie Tropicale. Ses recherches portent sur l’étude et la modélisation de la variabilité de la vapeur d’eau, des nuages et des cyclones tropicaux dans le sud-ouest de l’océan Indien. Depuis 2019, elle s'implique dans des projets régionaux de recherche pluridisciplinaire sur l'amélioration de la connaissance et la prévision du risque cyclonique. Dans la cadre du projet PISSARO cofinancé par l’Union Européenne et la Région Réunion (dans le cadre du programme opérationnel FEDER / programme de coopération INTERREG V Océan Indien), elle a animé la co-production avec la PIROI d'un outil d'aide à la décision pour l'anticipation de l'aléa cyclonique sur les terres du sud-ouest de l'océan Indien.
Responsable de la division Études et Climatologie de Météo-France pour l’Océan Indien (DIROI), est une experte météorologue diplômée de l'École Nationale de la Météorologie. Spécialisée dans l'étude du climat et des cyclones tropicaux du sud-ouest de l'océan Indien, elle a rejoint Météo-France en 2002.
Au Laboratoire de l'Atmosphère et des Cyclones (2009-2017), elle a contribué à améliorer les prévisions météorologiques en se focalisant sur l’intensification des cyclones tropicaux, et a soutenu sa thèse en 2012. Depuis 2014, elle préside des sessions lors des ateliers internationaux sur les cyclones tropicaux de l'Organisation Météorologique Mondiale, enrichissant la recherche dans ce domaine.
Depuis 2018, son champ d'action s'étend à la modélisation du climat et au développement de services climatiques pour les îles de l'océan Indien. Elle a dirigé le projet "Building Resilience in the Indian Ocean" (BRIO), financé par l'Agence Française pour le Développement, incluant la formation d'experts météorologiques régionaux et la communication sur les enjeux du changement climatique dans le bassin.
Pablo Tortosa obtient en 1997 un doctorat de génétique et physiologie des microorganismes de l’Université Paris-Saclay (ex Paris-Sud) durant lequel il étudie les mécanismes de régulation de l’expression des gènes en réponse aux sucres disponibles dans le milieu. Il réalise ces travaux sur Bacillus subtilis, une bactérie du sol innoffensive et particulièrement adaptée aux manipulations génétiques. Il poursuit ses recherches à New York, dans le cadre d’un post-doctorat (1997-2000) durant lequel il étudie la communication entre les bactéries, et plus particulièrement les statégies développées par les bactéries pour échanger avec les bactéries apparentées du matériel génétique, un mécanisme qui s’apparente donc à une forme primitive de sexualité bactérienne. Il rejoint en 2008 le Centre de Recherche et de Veille sur les maladies émergentes dans l’Océan Indien (CRVOI) qui deviendra l’UMR PIMIT (Unité Mixte de Recherche : Processus Infectieux en Milieu Insulaire Tropical). Dans cette UMR, Pablo s’attache à décrire les microorganismes zoonotiques ou à potentiel d’émergence dans les îles du Sud-Ouest de l’océan Indien, à en comprendre les cycles biologiques naturels, et enfin à identifier les conditions qui favorisent leur émergence en population humaine.
Chercheur à l'UMR AnimalS, santé, territoires, risques et écosystèmes (ASTRE), CIRAD-INRAE, il spécialiste des maladies émergentes à transmission vectorielle. Thierry est titulaire d'un doctorat obtenu en 1995 à l'Université de Montpellier (France) et a plus de vingt-cinq ans d'expérience dans la recherche, la surveillance et le contrôle des maladies à transmission vectorielle. Avant de revenir au CIRAD en septembre 2016 en tant que chercheur sur les maladies vectorielles émergentes, il a travaillé pour l'IRD et le CIRAD en Afrique et en Europe, puis à Ottawa comme spécialiste principal du programme Agriculture et Environnement du Centre de Recherches pour le Développement International (CRDI), un organisme gouvernemental canadien qui finance la recherche pour le développement. Il a conduit des recherches sur les maladies à transmission vectorielle, ainsi que des formations et des expertises pour plusieurs organisation (OMS, EFSA, DGAL, ANSES). Il a vécu et travaillé dans de nombreux pays africains, dont le Bénin où il a contribué à l'élaboration et à la coordination du premier Master international en entomologie médicale et vétérinaire. Il est affecté depuis 2019 au Cyroi de St Denis à La Réunion en tant que chercheur travaillant sur la prévention et le contrôle du risque vectoriel dans l’Océan Indien. Il a repris fin 2020 la coordination du DP One Health Océan Indien (www.onehealth-oi.org), un réseau régional de recherche et de formation contribuant à la prévention et au contrôle des risques infectieux et de l’antibiorésistance dans la région.
Professeur à l'Université de La Réunion et membre de l'UMR Entropie, il s'intéresse à l'écologie des prédateurs marins en lien avec la variation des conditions océaniques et à leur rôle dans le fonctionnement des écosystèmes marins tropicaux. Depuis 2016, Sébastien est responsable de la commission scientifique du centre sécurité requin, qui coordonne la gestion du risque requin à La Réunion.
Chercheur en halieutique à l'Ifremer. Il mène des recherches pour mieux comprendre la biologie et l'écologie des espèces marines exploitées afin de permettre une gestion durable de ces ressources. Il participe aux groupes scientifiques internationaux de la Commission des thons de l'océan d'Indien qui donnent les avis scientifiques sur l'état de santé des ressources de grands pélagiques dans cette zone.
Professeure de géographie et membre du laboratoire de recherche LIENSs (La Rochelle Université-CNRS). Elle a contribué comme auteure principale aux chapitres « Petites îles » des 5ème (2014) et 6ème (2022) rapports d’évaluation du GIEC. Ses recherches portent sur les changements environnementaux côtiers, les risques côtiers, et les politiques d’adaptation côtière au changement climatique dans les îles tropicales (océans Indien et Pacifique et Caraïbe). Elle s’intéresse à la nature et aux rythmes des changements qui s’opèrent à l’échelle pluri-décennale sous l’effet des pressions climatiques et anthropiques, et au rôle d’amortisseur de risque des écosystèmes côtiers et marins. Elle a développé une méthodologie d’évaluation des mesures d’adaptation fondées sur les écosystèmes et l’a appliquée à 26 projets Outre-Mer.